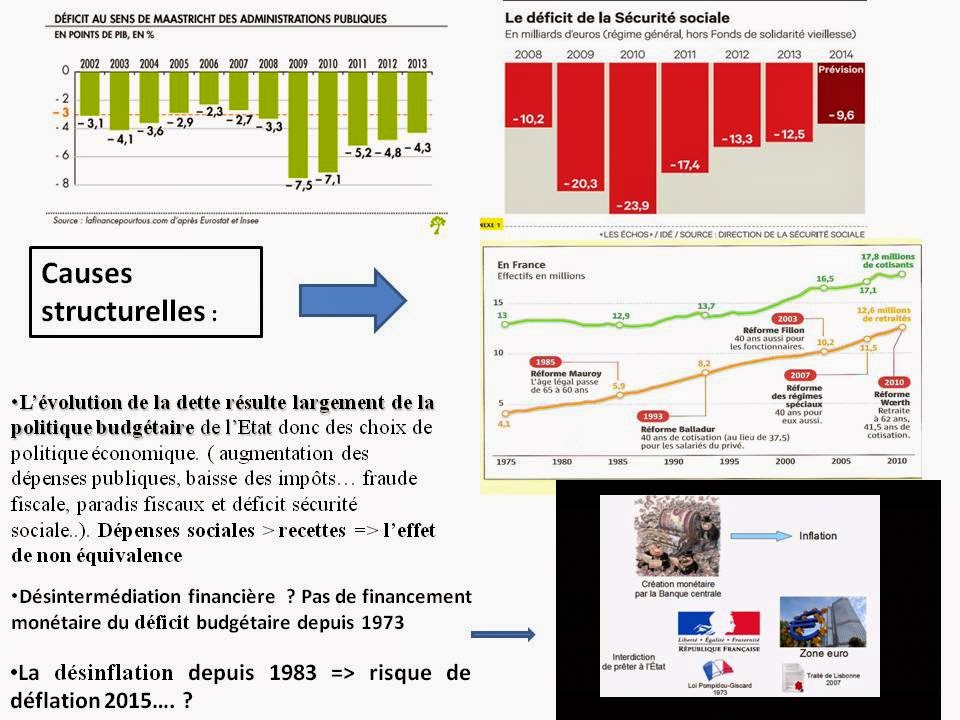15 nov. 2015
27 oct. 2015
Rente ou rendement, c'est toute la question de la croissance et du chômage !
Rente ou rendement ?
L'économie réelle est beaucoup plus taxée que l'économie financière virtuelle, c'est pourquoi il est devenu plus avantageux de placer ou de spéculer que d'investir ! La rente est donc préférée au rendement du capital technique par les détenteurs de capital ne se souciant que du rendement à court terme. Ainsi peu d'investissements =>peu de croissance=>peu d'emploi=> inégalités de revenus qui se creusent de plus en plus. Alors pour plus de croissance et d'emploi, il faut taxer davantage l'économie financière virtuelle et moins l'économie réelle.
21 oct. 2015
9 sept. 2015
Une prospérité sans croissance : la stagnation séculaire
" Pourquoi courir de plus en plus vite pour rester sur place ?"
Le paradoxe d'Easterlin !
Le paradoxe d'Easterlin !
2 sept. 2015
Le partage du travail : une solution Rocardienne au chômage !
Chômage :
la solution Rocard
Michel Rocard : "Travailler plus collectivement, mais moins
individuellement. Voilà la solution" :
Le retour d’une proposition, la réduction du temps de travail, -
aujourd’hui à contre-courant -, pour sortir de la crise du chômage. Michel
Rocard, l’homme du “parler vrai”, fait un retour remarqué dans le débat public.
Il le fait tel qu’en lui-même, c’est-à-dire en n’hésitant pas à sortir des
sentiers battus et à aller sur les voies innovantes. Son nouveau cheval de
bataille, avec son compère Pierre Larrouturou, un sujet devenu tabou en France,
la réduction du temps du travail. Un processus qu’il envisage de façon
radicale. “Pour résorber significativement notre chômage, passer aux 35 heures
ne suffit pas. Ce sont les 32 heures ou moins qu’il faut viser”, affirme-t-il.
A l’appui de sa démonstration, l’ex-Premier ministre met en avant le nombre
total d’heures travaillées durant les Trente Glorieuses – 41 milliards –
rapporté à la population active . Une nouvelle version du partage du travail ?
Michel Rocard détourne le slogan sarkozyste du “travailler plus” : “Travailler
plus, tous ensemble collectivement mais moins individuellement ! Voilà la
solution.”“Je n’aime pas le mot “crise”. En matière médicale, la crise,
c’est le temps fort de la maladie. Employer ce mot laisse supposer qu’on tient
pour anormal, surprenant et temporaire la phase dans laquelle on est, et qu’on
espère possible un retour à la situation antérieure. Or il ne s’agit pas du
tout de cela. Nous sommes devant des évolutions multiples différentes et
cumulatives, dont on ne sortira pas sans tout changer. A l’avenir, les choses
seront radicalement différentes dans tous les domaines : la nature, les objets,
l’activité économique, le temps de travail, les emplois, etc. Parler de crise
au singulier est une erreur. Je vous rappelle la phrase d’Henry Kissinger :
“Depuis l’origine de l’Histoire (soit tout de même 6 000 ans!), jamais aucune
génération n’a eu à faire face à autant de défis terribles et simultanés que
l’actuelle génération.” Ce mot de défi est préférable à celui de crise. Et les
défis sont nombreux, le premier, et pourtant l’un des moins commentés étant à
mon sens la perte de la capacité des économies développées à assurer le
plein-emploi.
Un chômage intolérable
Depuis maintenant 20 ans dans tous les pays développés, le chômage ne
régresse plus. Il s’est stabilisé entre 5 et 10 % selon les structures
sociales, les puissances syndicales, les habitudes des tribunaux en matière de
licenciement, les comportements traditionnels patronaux, etc. A ce chômage
s’ajoute la précarité. Contrats de durée de travail de quelques semaines, temps
partiel non choisi… Les précaires sont deux fois plus nombreux que les chômeurs
recensés. Il faut aussi compter les salariés dont les revenus sont inférieurs
au seuil de pauvreté. Chômeurs + précaires + travailleurs pauvres (les
catégories se recoupent parfois) englobent près d’un tiers de la population
active dans les pays développés. Une situation fondamentalement choquante que
l’on ne tolère que par habitude et qui est lourde de menace. La cause de
l’expansion de ce sous- emploi tient principalement au ralentissement
tendanciel de la croissance économique. Par paliers successifs, cette dernière
ne cesse pas de décliner. Le taux de croissance du PIB qui était de 5 % dans
les années des Trente Glorieuses est tombé successivement à 4 %, puis 3 % et en
dessous de 2 % depuis l’entrée dans le XXIe siècle. Les marchés en forte
expansion de l’après-guerre – l’automobile et les équipements blancs et bruns
(télévision, machine à laver…) deviennent des marchés de renouvellement à
croissance moindre et les marchés des nouveaux produits (téléphones mobiles,
ordinateurs …) sont de taille inférieure. Dans le même temps la hausse du
prélèvement actionnarial sur les résultats des entreprises (de 8 à 15 %) est
venue ralentir la progression du pouvoir d’achat des salariés alors que ce
dernier avait été la clé de la croissance pendant les Trente Glorieuses.
Parallèlement, les gains de productivité ont considérablement gonflé. Avec
l’informatique, les ordinateurs, les microprocesseurs et les robots, la
productivité s’accélère d’un rythme de 2 à 5 % l’an. Un “choc” d’une ampleur
considérable sur l’emploi que nous ne savons toujours pas gérer.
Une variable essentielle, la durée du travail
Face à un tel chômage et des perspectives de croissance aussi basses, il
n’y a pas d’autre solution que de rouvrir la question de la durée du travail.
La durée du travail est un des facteurs de l’équilibre du marché du travail.
J’en appelle ici au grand Keynes et non à quelques prophètes barbus ou
économistes en colère. En septembre 1930, en pleine crise, l’auteur de la
Théorie générale pronostique qu’à la fin du siècle il suffira de 3 heures par
jour - ou de 15 heures par semaine de travail salarié - pour que l’humanité
subvienne à ses besoins ! Je fais partie de ceux qui ont intégré cette vision :
il faut utiliser la variable du temps de travail pour se débarrasser du
chômage.
Le problème est qu’en France, la durée du travail fait partie de ces sujets
tabous qui lorsqu’on les aborde suscitent toutes sortes de débordements. Placez
le sujet dans la conversation, l’intelligence, la nuance, la précaution
disparaissent, le ton monte, on s’apostrophe, on cite des chiffres de partout
sans vérifier s’ils sont comparables ou compatibles entre eux et on profère
souvent des absurdités. De grâce cessons de nous quereller, et réfléchissons au
sujet avec tranquillité. Que les pouvoirs publics et les syndicats n’en
appellent d’abord plus à la loi pour traiter la question. Et que le monde
patronal accepte ensuite l’idée que la durée du travail est un des facteurs de
l’équilibre du marché du travail.
Le recours néfaste à la loi
Peu après la Deuxième Guerre mondiale en raison de l’effort de
reconstruction autour de 2 000 heures, puis à partir des années 50 elle reprend
son mouvement à la baisse si bien qu’à l’exception du Japon, partout en Europe
et en Amérique du Nord, elle se situe désormais entre 1 700 et 1 600 heures. Or
pour y parvenir, il n’y a qu’en France qu’on a eu recours à la loi car dans les
autres pays, le processus a été “naturel” et négocié. La loi sur les 40 heures
de 1936 a été tellement maladroite qu’elle a fait baisser la production. Elle
ne sera d’ailleurs effective qu’à partir de 1948. Il y a eu ensuite l’épisode
des 39 heures payées 40 en 1982. Une variation de moindre ampleur avec moins de
dommages sauf celui d’avoir découragé les quelques patrons et syndicalistes qui
s’apprêtaient à négocier. Puis survint la loi sur les 35 heures qui a provoqué
un affrontement hautement politisé, avec une charge symbolique extrême
entretenue par les médias. Quinze ans plus tard, on n’a toujours pas fait
convenablement le bilan de cette loi et encore moins l’analyse de ce qui a été
fait et pourquoi. Toutes les grandes entreprises françaises sont aux 35 heures,
ou en dessous alors que la quasi-totalité des PME ont refusé d’y aller et sont
restées à 37 ou 38 heures. Si bien qu’en raisonnant sur l’ensemble des
salariés, y compris ceux travaillant à temps partiel, la durée moyenne de
travail s’établit autour de 36,5-37 heures en France contre 33 heures en
Allemagne, 32 en Grande-Bretagne et en dessous de 31 heures aux Etats-Unis à la
fin 2012. Or ces 36,5-37 heures françaises sont corrollaires avec nos 5 millions
de chômeurs, toutes catégories de demandeurs d’emploi confondues !
Pour la semaine de 4 jours
L’idée qu’autour d’un horaire déterminé – que ce soit 36, 35 ou 32 heures -
on réaliserait instantanément le plein-emploi – et qu’on pourrait donc s’arrêter
là – est une idée idiote. Je suis moins à la recherche d’un chiffre symbole que
d’un processus intelligent, négocié et accepté pour pousser à la baisse aussi
loin qu’il le faudrait. Or il se trouve que pour résorber significativement
notre chômage, passer aux 35 heures ne suffit pas. De plus, une demi-heure de
moins de travail par jour ne présente pas de réel avantage pour un travailleur
qui consacre souvent beaucoup plus de temps à son trajet domicile-travail. Ce
qui peut avoir de l’intérêt, c’est de disposer d’une journée complète de libre.
S’occuper des enfants, bricoler, se cultiver, ca peut compter et ça soulage une
famille. C’est cette double idée qui nous a conduit – Pierre Larroturou et
moi-même – à accepter la symbolisation autour de la semaine de 4 jours
(4 jours à 8 huit heures font 32 heures). Mais ces 32 heures n’ont pas
plus de vertus symboliques que les 35 heures. Il se trouve tout simplement que
ce chiffre est en meilleure correspondance avec notre niveau de chômage à
combattre et avec un modèle d’application plus facile que celui des 4 journées
de travail.
Travailler plus mais tous ensemble
D’ores et déjà, environ 400 grosses PME ont choisi d’être à 32 heures pour
leur plus grand bénéfice car en général l’usine tourne 6 jours, ou au moins 5
et demi et avec au global plus de personnel au travail. Ce schéma n’est en rien
malthusien puisqu’il vise au contraire à accroître le nombre global d’heures
travaillées. “Travailler plus pour gagner plus !” Jamais Sarkozy, pas plus
d’ailleurs que ses ministres, n’ont précisé si cette formule s’appliquait au
niveau individuel ou à l’échelon collectif. Du temps des années de forte
croissance des années 60 et du début 70, la population active salariée
travaillait de l’ordre de 41 milliards d’heures de travail. Aujourd’hui, avec 5
millions de demandeurs d’emploi, le nombre d’heures fournies n’est plus que de
37 milliards. Ce sont ces heures perdues qu’il faut retrouver. Pour revenir au
plein-emploi et à ces 41 milliards d’heures, un simple calcul permet de déterminer
la durée du travail idoine. Ce n’est pas ma faute si l’arithmétique fait que
tous ensemble veut dire qu’on tombe à 32 heures, sinon moins !
Travailler beaucoup plus mais, tous ensemble collectivement et moins
individuellement, voilà la solution. Je suis prêt à en discuter avec tous ceux
qui acceptent les chiffres à la base de ce raisonnement.
www.lenouveleconomiste.fr
25 juin 2015
9 mai 2015
Réformer l'entreprise pour sortir de la crise !
Voir Le Monde 7 mai 2015 (lien)
L’entreprise est devenue aujourd’hui, à travers le C.I.C.E. (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) ou encore à travers le pacte de responsabilité et la recherche d’un nouveau dialogue social, la cible des politiques économiques conjoncturelles gouvernementales fondées sur l’offre. Elle est considérée désormais comme l’acteur économique principal pouvant sortir notre économie de la crise de l’emploi et de la faible croissance. L’enjeu est de taille, la réforme qui en découle l’est tout autant !
L’entreprise est devenue aujourd’hui, à travers le C.I.C.E. (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) ou encore à travers le pacte de responsabilité et la recherche d’un nouveau dialogue social, la cible des politiques économiques conjoncturelles gouvernementales fondées sur l’offre. Elle est considérée désormais comme l’acteur économique principal pouvant sortir notre économie de la crise de l’emploi et de la faible croissance. L’enjeu est de taille, la réforme qui en découle l’est tout autant !
Notre économie
dispose d’une pensée sur le marché, mais n’a pas de pensée de l’entreprise. En
effet, l’entreprise n’a pas d’existence propre en droit ni en économie. Elle
n’existe qu’à travers les personnes. Soit elle se confond avec la personne
physique, dans ce cas on parle d’entreprise individuelle. Elle n’existe donc
qu’à travers son créateur et fait partie de son patrimoine personnel. Soit elle
est une personne morale, dans ce cas elle est une société. Or le droit des
sociétés ignore le concept même d’entreprise. D’où ce paradoxe : les salariés qui sont
pourtant les parties prenantes essentielles de l’entreprise, sont étrangères au
contrat de société. Paradoxe encore, si l’on se tourne vers le droit du
travail, ce n’est pas l’entreprise qui passe les contrats de travail mais la
société. Cette ambiguïté a rendu possible la financiarisation de l’entreprise qui
s’est fortement développée à partir des années 80 grâce à la libéralisation des
marchés financiers et à leur globalisation. Cette transformation de la
propriété économique qui s’est tournée progressivement vers l’actionnariat, a
modifié la gouvernance de la grande entreprise dans laquelle les intérêts des
actionnaires priment sur ceux des salariés. Elle a aussi modifié son mode de
direction, en faisant des dirigeants de simples mandataires des actionnaires.
Ces gestionnaires sont désormais contraints de valoriser les actifs financiers avant les actifs
productifs, ce qui ralentit les investissements et l’innovation, et donc freine
la croissance et l’emploi dans notre économie. La relation entre
l’investissement et la finance s’étant inversée. Des investissements sont
abandonnés, non parce qu’ils ne sont pas rentables mais parce qu’ils ne sont
pas suffisamment rentables pour les actionnaires. En introduisant ainsi les
mécanismes de marché dans l’entreprise, cette financiarisation réduit peu à peu
ses finalités économiques, sociales et environnementales à la seule
maximisation du profit à court terme.
De plus, cette
introduction a modifié les liens de coordination dans les entreprises, car dans la logique de la financiarisation,
la gestion de la grande entreprise ne reconnait que les individus et non les
personnes. A la différence de l’individu, la personne ne peut pas être
dissociée des relations qu’elle crée. En dissociant ainsi l’individu de la
personne, ces modes de gestion réduisent l’intelligence collective de
l’entreprise et transforment son ciment social en une somme d’individus. En
privilégiant ainsi davantage l’individu plutôt que la personne, le travail ne devient
plus qu’une variable d’ajustement. Dès lors, il est plus facile pour
l’entreprise soucieuse de sa flexibilité, de se séparer des individus que des
personnes. Il est aussi plus facile pour elle, de réduire le coût du travail afin
d’améliorer la compétitivité plutôt que de valoriser la connaissance.
Dans ce contexte,
le choix d’une politique de l’offre centrée sur l’entreprise ne peut réussir à
rétablir la croissance et à créer des emplois durables qu’à la condition que
soit mise en œuvre une réforme structurelle de celle-ci et plus
particulièrement de la grande entreprise. Cette nouvelle conception de l’entreprise pourrait reposer sur trois rouages.
Le premier est
celui de la production. L’entreprise doit redevenir le lieu où l’on produit la
richesse économique. Cette fonction principale doit pouvoir s’exercer à travers
ses finalités économiques, sociales et environnementales, à partir desquelles les dirigeants sélectionnent les
moyens de financement en fonction des investissements et non l’inverse. Ce
renversement de la relation entre l’investissement et la finance nécessite une séparation
stricte entre les actionnaires-investisseurs et les actionnaires-spéculateurs
où seuls les premiers ayant contribué à la production percevraient les
dividendes.
Le second est
celui de la répartition de la richesse. La distribution des revenus entre le
travail et le capital ne doit plus être une répartition conflictuelle dans
laquelle l’un doit affaiblir l’autre pour se développer. Il faut bien au
contraire, réconcilier l’économique et le social par une nouvelle approche du
travail qui doit être appréhendé comme une ressource et non plus comme un coût.
La valeur travail doit donc reposer sur la reconnaissance des compétences des
salariés. Ce compromis ne pourrait se faire que par l’institutionnalisation
d’un dialogue social fondé sur un équilibre entre ces deux facteurs de
production.
Et le troisième rouage est le rouage territorial. Afin
de pouvoir exercer son rôle d’acteur économique principal, l’entreprise doit
ancrer ses activités sur le territoire grâce à un regroupement sur le même
territoire d’un réseau de compétences associant des entreprises, des écoles,
des universités, des laboratoires de recherche et des services publics
participant mutuellement à son essor. Ce lien territorial dissuaderait ainsi
les délocalisations. L’engrenage de ces trois rouages devrait faire naître une
nouvelle gouvernance en s’inspirant des sociétés coopératives et tracer les
perspectives d’une institutionnalisation de l’entreprise au service de
l’économie !
26 avr. 2015
Investissement : les chefs d'entreprise ne décident plus !
L’entreprise
est devenue plus que jamais l’acteur principal pour sortir notre économie du
chômage et de la faible croissance. Le dynamisme de l’économie française dépend
désormais des décisions des chefs d’entreprise. Ils détiennent les clés de la
relance économique par l’augmentation de leurs capacités de production et
doivent faire preuve d’une grande audace pour l’anticiper.
Leur audace pourrait être payante car la conjoncture semble favorable pour relever le défi de l’investissement. Toutes les conditions influençant les décisions d’investir sont mutuellement réunies.
Quelques indicateurs conjoncturels favorables à l’investissement…Leur audace pourrait être payante car la conjoncture semble favorable pour relever le défi de l’investissement. Toutes les conditions influençant les décisions d’investir sont mutuellement réunies.
Le retour de la croissance de l’économie française s’amorce peu à peu grâce à la baisse du prix du pétrole et à la dépréciation de l’euro. Cette diminution du prix du pétrole redonne du pouvoir d’achat aux ménages malgré la modération de leurs salaires depuis 2012. La consommation en France reste toutefois maintenue à la hausse. Ce sursaut conjoncturel de demande profite aux entreprises. Elles sont les grandes gagnantes de cette situation. La baisse des tarifs pétroliers, l’allègement fiscal lié au CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) et au pacte de responsabilité dont les premiers effets se font ressentir, ont contribué à faire baisser leurs coûts de production, améliorant ainsi leurs marges et leur compétitivité. De plus, la dépréciation de l’euro vient renforcer la compétitivité de celles qui exportent, voyant ainsi leurs carnets de commandes se remplir de nouveau. A cela, s’ajoute une diminution des taux d’intérêt sur les emprunts leur permettant d’accéder aux crédits à des conditions avantageuses.
Cependant ces déterminants économiques et financiers ne sont pas toujours suffisants pour relancer l’investissement. Les chefs d’entreprise n’ont pas toujours le pouvoir de décider d’investir ou encore celui de décider librement d’anticiper la demande. La décision d’investir ne leur appartient pas pleinement lorsqu’ils dirigent soit des grandes entreprises ou soit des PME. Leur choix d’investir est relatif.
… l’investissement sous tutelle
financière…
En effet depuis
la fin des années 80, la financiarisation des entreprises s’est fortement
développée grâce à la libéralisation des marchés financiers et à leur
globalisation. Cette transformation de la propriété économique qui s’est
tournée progressivement vers l’actionnariat, a modifié la gouvernance des
grandes entreprises en faisant des dirigeants de simples mandataires des
actionnaires. Ces gestionnaires dirigeants
sont désormais contraints de valoriser
les actifs financiers avant les actifs productifs. Aujourd’hui les
grandes entreprises consacrent deux fois plus d’argent aux versements de
dividendes qu’aux investissements. En sacrifiant ainsi leurs investissements au
profit des actionnaires, elles ralentissent la modernisation de leur processus
de production, diminuent leur productivité et perdent leur compétitivité.
Quant aux PME échappant
à cette gouvernance, elles ont actuellement l’opportunité d’investir en
recourant au crédit à des faibles taux. Encore faut-il que cette opportunité
soit acceptée et amplifiée par les banques, ce qui n’est pas toujours le cas. Aujourd’hui,
les banques encore endettées et traumatisées par la crise financière de 2008, restent
encore trop réticentes pour accorder des
crédits, préférant les placements aux investissements, jugeant ces derniers trop
risqués et peu rentables dans une phase
de reprise économique. N’ayant qu’une vision microéconomique et ne pouvant pas
mesurer l’effet multiplicateur de l’investissement sur l’ensemble de l’économie,
elles retardent par cette incertitude la réalisation de certains projets des
petites et moyennes entreprises susceptibles de générer de la croissance. Les
anticipations des chefs d’entreprise dépendent de celles consenties
conjointement par les banques. La croissance économique n’est plus entre les
mains de l’entrepreneur au sens de Schumpeter mais entre celles du banquier. Le
sas financier devient donc le passage obligé de l’investissement. Désormais,
c’est le crédit qui détermine le niveau et la nature de la production des
richesses plutôt que l’esprit d’entreprendre.
Inverser
la relation finance-investissement
Dans ce contexte,
la reprise de l’investissement ne peut réussir à relancer la croissance et à
créer des emplois qu’à la condition que l’Etat renverse la relation finance-investissement
en surtaxant les dividendes des actionnaires-spéculateurs et en détaxant ceux
des actionnaires-investisseurs. Mais aussi à la condition qu’il sépare grâce à la loi bancaire, les banques de dépôt des
banques d’investissement. Ces dernières disposant d’une véritable culture
macroéconomique seraient donc plus
consentantes à soutenir l’investissement !
Ce renversement redonnerait le goût du risque et de l’innovation aux chefs d’entreprise garantissant ainsi la croissance.
Ce renversement redonnerait le goût du risque et de l’innovation aux chefs d’entreprise garantissant ainsi la croissance.
Inscription à :
Articles (Atom)